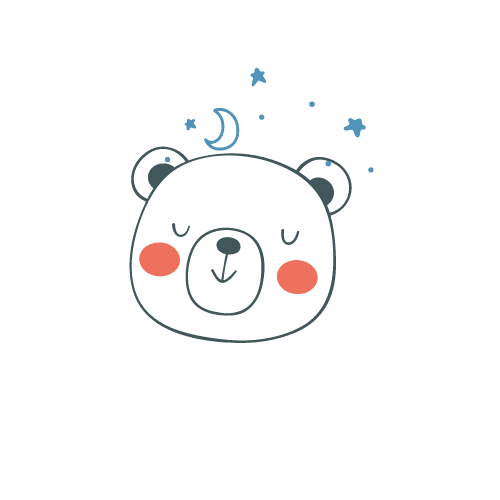Vers 18-24 mois, beaucoup de parents constatent un tournant dans le sommeil de leur enfant : des endormissements plus difficiles, des réveils nocturnes fréquents, et un refus de dormir seul. Ces changements peuvent être déstabilisants, mais ils sont souvent le reflet d’un développement psychique intense. Comprendre ce qui se joue dans la tête de l’enfant à cet âge permet d’adopter une posture parentale plus ajustée et de traverser cette période avec plus de sérénité.
Une période d’explosion psychique : toute-puissance et individuation
Entre 18 et 24 mois, l’enfant traverse une étape clé de son développement : la phase d’individuation. C’est à ce moment qu’il prend encore plus conscience qu’il est un être distinct de sa figure d’attachement principale (souvent sa mère ou son parent principal) et qu’il peut exister par lui-même. Ce processus est rendu possible grâce à deux acquisitions fondamentales :
- La permanence de l’objet : l’enfant comprend que ses parents continuent d’exister même lorsqu’ils sont hors de sa vue.
- La représentation mentale : il peut se représenter intérieurement les figures d’attachement, ce qui lui permet de les « garder avec lui » en leur absence.
Avec cette nouvelle conscience de lui-même, l’enfant entre dans une phase de toute-puissance narcissique : il se perçoit comme grand, capable, affirmé. Il revendique son autonomie, s’affirme en disant « non », s’oppose, explore… tout en restant profondément dépendant du regard et du soutien de l’adulte. Cette période est souvent appelée, à tort, « les terrible two » ; en réalité, il s’agit d’une étape de grandissement où l’enfant évolue de manière fascinante et belle à observer. Cela nécessite toutefois un ajustement subtil de la communication parentale, pour répondre à ses besoins d’affirmation tout en l’aidant à se sécuriser dans ses nouvelles découvertes.
L’ambivalence du « rapprochement » : entre indépendance et besoin d’amour
Margaret Mahler, pédiatre et psychanalyste, parle de la période de rapprochement. À ce stade, l’enfant alterne entre des élans d’autonomie (« je fais tout seul ! ») et un intense besoin d’attention, d’affection, de validation. Il attend une présence affective de qualité, il veut que l’adulte soit psychiquement disponible, attentif à ses émotions, à ses initiatives, à ses craintes.
C’est aussi une période de grande ambivalence émotionnelle : l’enfant peut devenir plus jaloux, plus envieux, plus agressif. Ces manifestations sont normales et liées à son développement. Il expérimente des émotions intenses qu’il ne sait pas encore réguler seul.
Et le sommeil dans tout ça ?
Ce tumulte intérieur se manifeste souvent… la nuit. L’enfant peut refuser de dormir seul, car il vit l’endormissement comme une séparation. Il peut appeler plusieurs fois, réclamer des câlins, demander à vérifier que l’adulte est toujours là. Les réveils nocturnes peuvent augmenter, en lien avec les émotions vécues dans la journée ou les tensions internes non exprimées. Ce n’est pas un « caprice » ni une « manipulation » : l’enfant exprime un besoin réel d’être sécurisé dans sa conquête de l’autonomie.
Comme le rappelle Winnicott, l’enfant ne peut se sentir vraiment seul que s’il a été suffisamment accompagné, suffisamment contenu. C’est dans cet espace sécurisant qu’il pourra se lâcher prise, accepter l’idée de dormir seul et se prouver à lui-même qu’il peut le faire. En effet, l’excès de protection peut être un frein majeur à cette autonomie.
L’activisme parental : un obstacle à l’autonomie
L’intention des parents est souvent bienveillante, mais un excès de protection peut nuire à l’autonomie de l’enfant. Un activisme parental excessif, où les parents anticipent chaque besoin, chaque désir, chaque inquiétude, empêche l’enfant de se confronter à ses propres émotions et d’apprendre à les gérer seul.
L’enfant a besoin de l’espace pour essayer, échouer, se tromper et, au final, découvrir et apprendre. Ce n’est pas en intervenant systématiquement pour « réparer » ou « soulager » chaque petit malaise que l’on aide l’enfant à développer sa confiance en lui et son autonomie. Au contraire, cela peut l’amener à penser que lui seul ne peut pas résoudre ses difficultés, et que ses tentatives sont vouées à l’échec.
Il faut permettre à l’enfant d’expérimenter et de ressentir les explorations et tentatives, puis de dépasser cette frustration. En le soutenant sans intervenir systématiquement, on l’aide à se construire, à se prouver qu’il est capable, à sentir qu’il sait faire. Sinon, l’enfant risque de rester dans une relation où il est continuellement dépendant de l’adulte pour se sentir rassuré ou compétent.
Quelle posture parentale adopter pour soutenir le sommeil à cet âge ?
- Rassurer sans surinvestir : répondre avec constance, sans céder à toutes les demandes, mais en restant émotionnellement présent. L’enfant a besoin de sentir que l’adulte est stable, même quand lui vacille.
- Accueillir les émotions du soir : plutôt que de minimiser les pleurs ou les inquiétudes, les nommer :
« Tu sembles inquiet ce soir, tu aurais besoin que je reste un peu ? » Cela favorise l’élaboration psychique et permet à l’enfant de gérer ses émotions sans être constamment secouru. - Soutenir l’estime de soi : valoriser ses compétences d’endormissement quand elles apparaissent (« Tu t’es endormi tout seul hier soir, tu grandis ! »), tout en restant disponible si c’est plus difficile un autre soir.
- Instaurer des rituels stables : à cet âge, les repères sont fondamentaux. Un rituel apaisant, répété chaque soir, aide l’enfant à anticiper la séparation de la nuit.
Conclusion : accompagner le sommeil, c’est accompagner l’individuation
Le sommeil entre 18 et 24 mois n’est pas simplement une question d’horaires ou de fatigue : c’est une étape fondatrice dans le développement du sentiment d’autonomie, du lien à l’autre et de l’estime de soi. En tant que parent, adopter une posture à la fois contenante, sécurisante et respectueuse du besoin d’indépendance permet d’offrir à l’enfant un cadre propice à un sommeil plus apaisé, et à une croissance affective harmonieuse.
L’important est de savoir où placer la limite : entre un soutien rassurant et un soutien excessif. L’enfant doit se sentir suffisamment accompagné pour pouvoir tester, expérimenter,se faire confiance. Seul ainsi il pourra intégrer l’idée qu’il est capable de trouver le sommeil par lui-même, et qu’il n’a pas besoin d’être constamment porté dans ce processus jusqu’au bout.
Je suis Charlotte Pouyet, thérapeute parentale, spécialiste du sommeil du bébé et de l’enfant. Je reçois en visio ou au cabinet les parents qui rencontrent des difficultés autour du sommeil de leur enfant, de 0 à 6 ans.